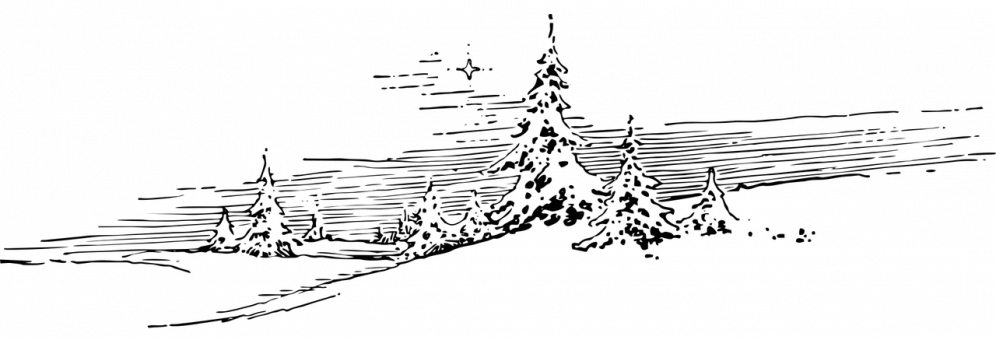ObsAnt

Près de quatre ans que l’Observatoire de l’Anthropocène existe ! Dont 3 ans sous sa forme actuelle.
Une première version de « Veille documentaire » a été proposée dès 2015 sous une autre appellation.
Avec les années, ce sont plus de 37.000 références qui ont été collationnées, réparties en thématiques, agrémentées de mots-clés et mises à disposition de toutes et tous.
Récemment :
Grâce à un changement d’hébergement , la consultation est devenue fluide et rapide.
La page d’accueil (la Une) a été modifiée avec :

![]()

- la mise en avant de quelques références récentes ;
- un Focus et un Coup d’œil pour attirer l’attention sur des thématiques précises ;
- quelques liens vers des thématiques ;
- et les derniers articles proposés sur le blog.
Le blog :
Depuis 2020, plus de 120 articles originaux, traductions ou reprises ont été publiés sur le blog.
Une page liste l’ensemble des articles parus. Il est possible de les sélectionner par années ou via des présélections thématiques : https://obsant.eu/blog/liste/
Et aussi :

Au cœur de l’Observatoire, la «Veille » affiche les références récentes et permet de faire des recherches : https://obsant.eu/veille/ . Des améliorations de cet outil sont en préparation. Patience.

Autre entrée importante dans la documentation, la page « Thématiques » qui donne une vision très complète de l’ensemble des contenus référencés : https://obsant.eu/thematiques/
Et encore :
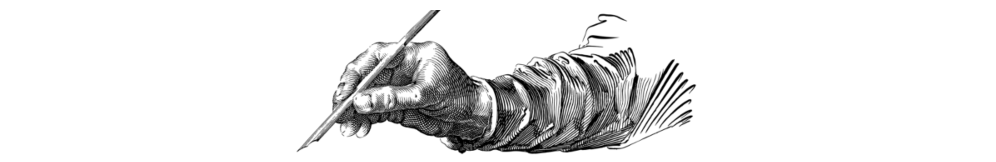
Il est possible également de consulter une sélection de médias dont sont issus les références – https://obsant.eu/medias/ – et une sélection des autrices et auteurs : https://obsant.eu/selection-auteurs/

Un outil appelé « Flux continu » permet de suivre le référencement dans la base de données : https://obsant.eu/flux-continu/
Langues :
Comme nous référençons régulièrement en anglais, une page y est consacrée : https://obsant.eu/english/
Sans oublier les propositions de références en néerlandais qui se retrouvent soit en tapant anthropoceen.eu, via le menu ou directement : https://obsant.eu/opvolging/
Activités :
L’Observatoire organise ou soutient régulièrement des rencontres et évènements sur les thématiques de l’Anthropocène.

L’équipe est entièrement bénévole et les frais de fonctionnement réduits au maximum.
Pour nous soutenir :
Le compte bancaire de l’association de fait est :
Observatoire de l’Anthropocène
Numéro de compte : BE82 1030 7636 8168
BIC : NICA BE BB