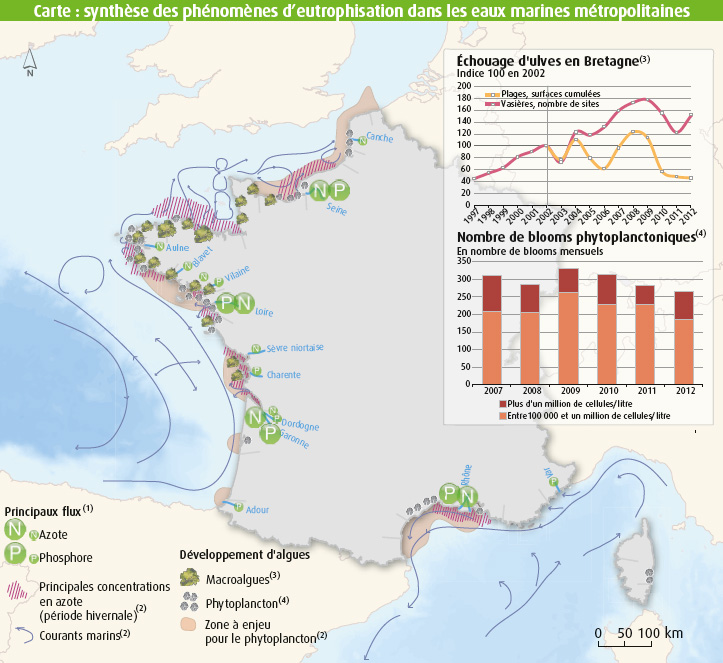La prochaine frontière de l’humanité sur cette planète
Mauricio Herrera Kahn (*)
image – pixabay – gerald
« L’avenir n’est pas un destin écrit, c’est une décision collective. »
L’humanité a franchi toutes les frontières visibles. Du feu à la roue, de la poudre à canon à la bombe atomique, de la voile au saut vers la Lune. Nous avons ouvert la croûte terrestre pour en extraire des minéraux, construit des villes qui brillent comme des étoiles artificielles, connecté la planète entière en quelques secondes, et pourtant nous sommes toujours prisonniers des mêmes guerres tribales d’il y a 3 900 ans, aujourd’hui maquillées de drones, d’algorithmes et d’ogives nucléaires.
La question n’est plus de savoir si nous pouvons continuer à conquérir des territoires. La question est de savoir quelle frontière compte vraiment désormais. Elle ne sera ni géographique ni militaire. Elle sera technologique, sociale, sanitaire, politique, environnementale, écologique, pacifique, anarchique, spirituelle, utopique et mentale. Il s’agira de décider si nous progressons vers une humanité digne ou si nous répétons l’histoire de la cupidité et du pillage.
La prochaine frontière de l’humanité ne se mesure pas en kilomètres ni en missiles. Elle se mesure en justice, en empathie et en courage collectif.
1. La frontière technologique
La technologie a toujours été l’atout majeur de notre espèce. La maîtrise du feu en a été la première étincelle ; l’intelligence artificielle est la plus récente. Aujourd’hui, nous investissons davantage dans les algorithmes que dans l’alimentation. En 2024, les dépenses mondiales consacrées à l’intelligence artificielle ont atteint 190 milliards de dollars et devraient dépasser 2 % du PIB mondial d’ici 2030. La biotechnologie poursuit son expansion : un marché qui atteindra 1 500 milliards de dollars avant la fin de la décennie, promettant de modifier les gènes, de prolonger la vie et peut-être d’éradiquer des maladies.
La frontière technologique semble infinie. La colonisation de Mars coûtera plus de 100 milliards de dollars, mais la NASA et SpaceX ont déjà fixé des dates. La Chine envisage d’établir des bases lunaires permanentes. Parallèlement, des puces implantées dans le cerveau permettent aux bras robotisés de se déplacer, et des startups de la Silicon Valley vendent des pilules de longévité.
Le risque ne réside pas dans la technologie, mais dans celui qui la contrôle. Cinq entreprises concentrent plus de 80 % des investissements mondiaux dans l’IA, et leurs conseils d’administration décident davantage de notre avenir que bien des parlements. Le rêve de prolonger la vie peut se transformer en privilège de prolonger la richesse. La biotechnologie peut nous libérer du cancer ou devenir la nouvelle frontière du profit pharmaceutique.
La frontière technologique est là, elle bat à toute vitesse. La question est de savoir si elle deviendra un outil d’émancipation collective ou une nouvelle cage dorée aux mains de quelques-uns.
2. La frontière sociale
Les inégalités sont une plaie ouverte qu’aucune technologie ne peut guérir. La planète produit suffisamment pour nourrir tout le monde, mais les richesses sont accumulées par une minorité obscène. Selon Oxfam 2024, les 1 % les plus riches possèdent 45 % des richesses mondiales, tandis que des millions de personnes restent prisonnières de la misère quotidienne.
L’Afrique, berceau de l’humanité et continent pillé pendant des siècles, continue de subir le poids de l’indifférence mondiale. Selon la Banque mondiale, 40 % de la population y vit avec moins de 2,15 dollars par jour. Ce n’est pas une statistique économique, c’est une condamnation à mort : la faim, le manque d’accès à l’eau et à l’éducation.
Le coût de l’éradication de la faim sur la planète est estimé à 330 milliards de dollars par an. Ce chiffre paraît énorme si on le compare aux dépenses militaires mondiales, qui dépassent les 2 440 milliards de dollars. Éradiquer la faim coûterait moins de 20 % de ce que l’humanité dépense en armements pour continuer à s’autodétruire.
La frontière sociale est la plus cruelle, car elle ne dépend ni de la science futuriste ni de la colonisation de planètes lointaines. Elle dépend d’une décision politique et éthique. L’humanité peut-elle accepter que, pendant qu’un milliardaire voyage dans l’espace grâce au tourisme orbital, des millions d’enfants n’aient pas de quoi manger ?
La prochaine frontière n’est pas la conquête de Mars, c’est la conquête de la dignité sur Terre.
3. La frontière sanitaire
La santé est la frontière la plus intime de l’humanité. Il ne s’agit pas de conquérir des galaxies, mais de survivre à son propre corps. Chaque année, le cancer tue 10 millions de personnes, selon l’OMS, tandis que le diabète handicape 537 millions d’adultes dans le monde (IDF). Ce n’est pas l’avenir, mais le présent qui engloutit silencieusement vies et ressources.
La science promet des thérapies géniques, l’édition CRISPR et une médecine personnalisée permettant d’anticiper les tumeurs avant leur apparition. Mais le prix de cette promesse est inaccessible pour la plupart. Le médicament le plus cher au monde, le Zolgensma, coûte 2,1 millions de dollars par dose. Une seule injection vaut plus que la vie entière de milliers de familles du Sud.
La frontière sanitaire n’est pas seulement scientifique, elle est éthique. Pouvons-nous accepter qu’un remède existe et soit refusé à cause du prix ? Aujourd’hui, plus de 50 % de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé essentiels (OMS). Les pays pauvres représentent 93 % de la charge de morbidité, mais seulement 11 % des dépenses mondiales de santé. En Afrique, les dépenses de santé par habitant s’élèvent à peine à 150 dollars américains par an, tandis qu’aux États-Unis, elles dépassent 13 000 dollars américains.
La prochaine frontière de l’humanité se mesure en lits d’hôpitaux, en vaccins universels et en accès réel aux médicaments. Les dépenses mondiales de santé s’élèvent à 9 800 milliards de dollars par an, mais un tiers est gaspillé à cause de l’inefficacité et de la corruption (OMS). Si cette richesse était répartie équitablement, au moins 20 millions de vies pourraient être sauvées chaque année. Sans franchir cette frontière, la longévité promise par les biotechnologies restera un privilège réservé aux élites et non le droit fondamental de vivre dignement partout sur la planète.
4. La frontière politique
La politique est la frontière où l’humanité bute sans cesse. On parle de démocratie universelle, mais en pratique, seuls 24 pays sont considérés comme des démocraties à part entière selon l’Indice de démocratie 2024. La majorité d’entre eux évoluent entre démocraties défaillantes, démocraties hybrides et dictatures pures et simples. Les 59 régimes autoritaires actuels englobent 37 % de la population mondiale – des milliards d’êtres humains qui ne choisissent pas leur destin.
Le pouvoir reste aux mains des élites économiques et militaires. Aujourd’hui, on compte plus de 400 000 lobbyistes enregistrés aux États-Unis et dans l’Union européenne, qui dépensent plus de 10 milliards de dollars par an pour influencer les décisions politiques.
Soixante-dix pour cent des campagnes électorales mondiales sont financées par de grandes entreprises, et le prix d’une présidence se mesure davantage en chèques qu’en votes. L’ONU, créée pour empêcher une nouvelle guerre mondiale, est devenue un parlement impuissant où cinq puissances disposant d’un droit de veto bloquent l’avenir de huit milliards de personnes.
Le contraste est saisissant. Alors que l’humanité dépensera 2 440 milliards de dollars en armement en 2023 (SIPRI), les parlements nationaux sont tiraillés entre scandales de corruption et coupes sociales. Ce montant pourrait financer dix fois les 330 milliards de dollars nécessaires à l’éradication de la faim dans le monde ou couvrir les 4 500 milliards de dollars annuels requis par l’Agence internationale de l’énergie pour enrayer la crise climatique d’ici 2030.
La frontière politique n’est ni une carte ni une constitution. C’est la décision de redéfinir le pouvoir à l’échelle planétaire. Aujourd’hui, 59 millions de personnes sont déplacées par les guerres et les persécutions, tandis que les dirigeants débattent de frontières artificielles. Le PIB mondial avoisine les 105 000 milliards de dollars, mais moins de 1 % est consacré à la coopération internationale. La politique actuelle gère la mort ; la frontière à venir doit la transformer en art de garantir la vie. Tant que nous n’aurons pas franchi ce seuil, nous resterons prisonniers du même théâtre de drapeaux, d’urnes et d’armées qui répète l’histoire de la cupidité.
5. La frontière environnementale
La planète est entrée dans l’Anthropocène, une ère où l’empreinte humaine est devenue une force géologique. La crise climatique n’est plus une menace future : les incendies ravagent les continents, les ouragans se multiplient, les sécheresses assèchent les rivières. La perte de biodiversité est l’autre face de la catastrophe : environ 150 espèces disparaissent chaque jour, selon l’ONU. Parallèlement, 43 millions de personnes ont été déplacées pour des raisons environnementales au cours de la dernière décennie, et ce chiffre pourrait atteindre 200 millions d’ici 2050 (HCR).
Les températures mondiales ont déjà augmenté de 1,48 °C par rapport aux niveaux préindustriels (NOAA 2024). Cela peut paraître insignifiant, mais chaque dixième de hausse déclenche des tempêtes, élève le niveau de la mer et menace les cultures. Les émissions mondiales de CO₂ atteindront 37,4 milliards de tonnes en 2023, un record qui contredit tous les discours sur la transition écologique.
La frontière environnementale exige de repenser notre relation à la terre. Il ne s’agit pas d’« atténuer les dommages », mais de changer de modèle civilisationnel. L’Agence internationale de l’énergie estime que 4 500 milliards de dollars d’investissements annuels dans les énergies propres sont nécessaires d’ici 2030 pour respecter les engagements climatiques.
Aujourd’hui, à peine la moitié de ce montant est investie. Parallèlement, les subventions aux combustibles fossiles ont dépassé 1 300 milliards de dollars en 2022, soit le double du montant alloué aux énergies renouvelables.
La justice climatique est au cœur de ce défi. Les pays du Sud génèrent moins de 15 % des émissions historiques, mais subissent plus de 80 % des catastrophes climatiques. Refonder signifie abandonner la logique du pillage et reconnaître qu’il ne s’agit pas de sauver la nature, mais de nous sauver nous-mêmes avec elle.
5a. La frontière écologique
Si la frontière environnementale mesure le climat et l’énergie, la frontière écologique mesure la vie elle-même. La planète se vide de son sang en silence. Chaque année, 10 millions d’hectares de forêt disparaissent (FAO), soit une superficie équivalente à celle de l’Islande. L’Amazonie, cœur vert de la Terre, a déjà perdu 17 % de sa couverture originelle ; si elle atteint 25 %, elle atteindra un point de non-retour et deviendra une savane.
L’eau douce, essentielle à la survie de toute civilisation, est gravement menacée. 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable (ONU-Eau). Plus de 1,9 milliard de personnes dépendent du recul rapide des glaciers. La fonte des glaces au Groenland et en Antarctique pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer pouvant atteindre 2 mètres d’ici 2100, détruisant ainsi des villes côtières qui abritent actuellement plus de 600 millions de personnes.
La biodiversité s’effondre. 69 % des populations de vertébrés ont décliné depuis 1970 (Rapport Planète Vivante du WWF). Environ 150 espèces disparaissent chaque jour ; il s’agit de la plus grande crise de la vie depuis qu’une météorite a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d’années.
La frontière écologique est aussi culturelle. Quatre-vingt pour cent de la biodiversité mondiale se concentre sur les territoires autochtones, protégés par des communautés qui ont résisté à des siècles de pillage. Elles offrent la vision la plus avancée de la durabilité : vivre avec la terre, et non contre elle.
Reconstruire cette frontière, c’est reconnaître que nous ne sommes pas propriétaires de la planète ; nous en sommes les hôtes. Si les rivières meurent, l’humanité meurt. Si les forêts se taisent, il n’y aura plus d’oxygène pour nos utopies. La frontière écologique n’est pas facultative : c’est la ligne rouge de l’existence.
6. La frontière de la paix
La guerre demeure l’échec le plus retentissant de l’humanité. Près de quatre millénaires se sont écoulés depuis les premières chroniques de conquêtes, et nous sommes restés les mêmes : villages rasés, villes incendiées, enfants réduits à l’état de chiffres. En 2024, on comptait 55 conflits armés actifs, selon le Programme de données sur les conflits d’Uppsala.
Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont des tragédies quotidiennes : Gaza, l’Ukraine, le Yémen, le Soudan, la Syrie, le Myanmar, le Sahel, le Congo, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Liban – chacun avec ses morts, ses déplacés, sa faim. Rien qu’en 2024, les violences politiques ont fait plus de 200 000 morts, et les personnes déplacées de force comptent désormais plus de 114 millions dans le monde.
Le paradoxe est brutal. Les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 440 milliards de dollars en 2023 (SIPRI), tandis que l’aide humanitaire internationale atteignait à peine 46 milliards de dollars (ONU). Autrement dit, pour chaque dollar dépensé pour sauver des vies, plus de 50 sont consacrés au perfectionnement de l’industrie de la mort. La paix ne sera jamais possible tant que la balance penchera en faveur des armes.
Le business de la guerre est évident. Les fabricants d’armes multiplient leurs profits : rien qu’en 2023, les 100 plus grandes entreprises du secteur ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 600 milliards de dollars. Chaque missile tiré en Ukraine ou à Gaza constitue un transfert direct de ressources publiques vers des entreprises privées. Le coût de la guerre n’est pas supporté par ceux qui décident ; il est payé par la population civile en vies humaines, en faim et en ruines. La reconstruction est aussi un business : entrepreneurs, banques et fonds d’investissement se partagent des contrats de plusieurs millions de dollars sur les décombres.
L’ombre du nucléaire est toujours là, menaçant d’anéantir l’humanité en quelques secondes. On compte 12 100 ogives nucléaires actives sur la planète, dont 90 % sont aux mains des États-Unis et de la Russie. Une seule détonation suffirait à condamner la planète à un hiver nucléaire. Et pourtant, des milliards sont dépensés chaque année pour moderniser des arsenaux qui ne devraient jamais être utilisés.
Ceux qui paient la guerre sont toujours les populations. Ceux qui paient sont les enfants déplacés qui ne retourneront jamais à l’école, les mères qui enterrent leurs enfants, les personnes âgées qui fuient sans destination. Ceux qui paient aussi sont les contribuables qui financent les armées et les armes par leurs impôts. Ceux qui en profitent sont une minorité : les complexes militaires, les élites politiques qui consolident leur pouvoir, les États qui s’assurent des ressources stratégiques. Tant que cette équation ne changera pas, la paix restera la frontière la plus lointaine.
7. La frontière de l’anarchie
L’anarchie n’est pas le chaos ; c’est la possibilité d’un ordre sans maîtres. Depuis des siècles, le pouvoir nous a appris à le craindre, à le confondre avec la violence ou le désordre. Mais en pratique, un monde existe déjà, régi par des règles différentes : coopération, autogestion, entraide.
Selon l’Alliance coopérative internationale, on compte aujourd’hui plus de 3 millions de coopératives dans le monde, représentant 1,2 milliard de personnes. Leur poids économique équivaut à près de 10 % du PIB mondial. Loin d’être une curiosité marginale, elles démontrent qu’il est possible d’organiser la production et la distribution sans dépendre des banques d’investissement ou des sociétés extractives.
Lors de la crise financière de 2008, le taux de faillite des coopératives de crédit était 70 % inférieur à celui des banques privées, ce qui démontre que l’autogestion est plus stable que le capital spéculatif.
Au Rojava, dans le nord de la Syrie, 4 millions de personnes vivent sous un système communautaire. Plus de 4 000 coopératives gèrent l’agriculture, le commerce et les services en pleine guerre, les conseils de quartier et les assemblées de femmes constituant le fondement de la vie politique. C’est la démocratie directe, pratiquée au quotidien sous la menace turque et l’indifférence de l’Occident.
Au Chiapas, les zapatistes maintiennent depuis des décennies un territoire de 300 000 habitants organisé en caracoles et en conseils de bon gouvernement. Ici, ni banques internationales ni partis politiques ne dictent les règles. Il existe des écoles autonomes, des dispensaires et des systèmes judiciaires locaux. C’est une frontière vivante qui démontre que l’autogestion peut soutenir des territoires entiers.
Le contraste est saisissant. Les dix plus grandes entreprises mondiales représentent un chiffre d’affaires équivalent à 25% du PIB mondial, mais, dans le même temps, on compte plus de 900 000 entreprises sociales qui emploient 14 millions de personnes et mobilisent plus de 150 milliards de dollars US en microfinance communautaire. Tandis que le capital s’accumule au sommet, la résistance grandit à la base.
La frontière de l’anarchie ne propose pas un vide ; elle propose une autre façon de vivre : un ordre bâti par le peuple, et non sur lui. Là où l’État échoue et où les entreprises pillent, les communautés préparent déjà l’avenir.
8. La frontière spirituelle
Le pouvoir économique des institutions religieuses est considérable. Le Vatican gère un budget annuel de 803 millions de dollars (2022), mais l’Église catholique mondiale gère des biens et des actifs évalués à des centaines de milliards de dollars. En Amérique latine, les églises évangéliques mobilisent plus de 30 milliards de dollars par an en dîmes, en projets éducatifs et en médias. Aux États-Unis, les méga-églises collectent individuellement jusqu’à 70 millions de dollars par an, et certaines rassemblent 50 000 personnes par semaine, soit plus qu’un stade de football.
Parallèlement, le nombre de ceux qui quittent l’Église s’accroît. Les personnes dites « sans appartenance » comptent aujourd’hui 1,2 milliard de personnes, soit près de 16 % de l’humanité. Dans des pays comme la Suède, la République tchèque et l’Estonie, plus de 60 % de la population se déclare sans religion. Le phénomène s’amplifie également en Amérique latine : au Chili, la proportion de personnes sans appartenance religieuse est passée de 12 % en 2002 à plus de 30 % en 2023.
La frontière spirituelle ne se situe pas entre croyants et non-croyants, mais entre les religions transformées en entreprises et les spiritualités comprises comme une éthique de vie. En Afrique, le concept d’Ubuntu guide des millions de personnes dans l’idée que « je suis parce que nous sommes ». En Amérique latine, le Buen Vivir andin inspire les politiques publiques en Bolivie et en Équateur. En Palestine, le Sumud soutient les communautés sous occupation depuis plus de 70 ans.
Le risque est évident, et lorsque les religions deviennent des machines de pouvoir, elles peuvent financer des guerres. L’Arabie saoudite a dépensé plus de 4 milliards de dollars pour exporter son idéologie wahhabite ces dernières décennies, alimentant ainsi les conflits (The Guardian, Council on Foreign Relations et Foreign Affairs). L’opportunité est également évidente : des mouvements interconfessionnels pour la paix, comme celui d’Assise en 1986, ont réussi à rassembler les dirigeants de plus de 50 confessions dans un appel commun à la non-violence.
La prochaine frontière spirituelle exige de laisser derrière soi le dieu de l’argent et de revenir à une éthique commune. Aujourd’hui, les inégalités s’expriment également dans le domaine spirituel : tandis que certains chefs religieux amassent des fortunes personnelles de plus de 50 millions de dollars, des millions de fidèles vivent dans l’extrême pauvreté. Reconstruire cette frontière spirituelle signifie placer le respect de la vie, la solidarité et la justice au cœur de nos préoccupations, car sans une âme collective qui nous unit, il n’y aura pas d’avenir possible.
9. La frontière des utopies
Les utopies étaient autrefois ridiculisées, considérées comme des rêves impossibles, mais elles s’invitent aujourd’hui dans les budgets des gouvernements et des entreprises. L’humanité investit déjà 40 milliards de dollars dans les thérapies anti-âge (Longevity Industry Reports 2024), un marché qui pourrait dépasser les 600 milliards de dollars d’ici 2030. La Silicon Valley mise sur une espérance de vie supérieure à 150 ans, et les expériences sur l’édition génétique, les cellules souches et la nanomédecine constituent le laboratoire où cette promesse est testée.
L’espérance de vie humaine la plus élevée jamais enregistrée reste celle de Jeanne Calment, avec 122 ans. Aujourd’hui, l’espérance de vie moyenne mondiale dépasse à peine 73 ans, mais dans des pays comme le Japon, elle atteint 84 ans, tandis que dans les pays africains ravagés par la famine et la guerre, elle reste inférieure ou égale à 50 ans.
La frontière de la longévité pourrait devenir une nouvelle fracture : des élites qui vivent deux siècles et des populations entières condamnées à mourir avant 60 ans.
Les villes utopiques progressent également. Plus de 250 projets de villes intelligentes sont en cours de construction dans le monde. L’Arabie saoudite planifie Neom, dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars, conçue comme une étendue futuriste dans le désert. La Chine développe plus de 30 éco-villes promettant zéro émission. L’Afrique teste sa propre vision avec Eko Atlantic au Nigeria, une ville conçue pour résister à la montée du niveau de la mer. Mais la question demeure : seront-elles des villes heureuses ou des laboratoires de contrôle social et de surveillance numérique ?
Les utopies ne sont pas seulement urbaines ou biologiques. Des milliers d’expériences de monnaies locales, de banques éthiques et de réseaux coopératifs émergent dans l’économie. Aujourd’hui, il existe plus de 7 000 systèmes monétaires alternatifs dans le monde, conçus pour échapper à la domination des banques centrales. Parallèlement, les Objectifs de développement durable des Nations Unies exigent un investissement annuel de 5 000 à 7 000 milliards de dollars d’ici 2030, mais le déficit de financement dépasse déjà 2 500 milliards de dollars par an.
La frontière des utopies n’est pas un rêve éthéré ; c’est l’urgence d’imaginer autre chose. Vivre 200 ans, habiter des villes sans faim ni pollution, créer des économies sans usure. Tout cela est débattu aujourd’hui dans les laboratoires, les ministères et les mouvements sociaux. L’utopie n’est plus de la littérature : c’est le projet politique le plus urgent du XXIe siècle.
10. La frontière mentale
L’esprit humain est le territoire le plus vaste et le plus inconnu. Nous avons atteint Mars avec des sondes et les fonds marins avec des sous-marins, et pourtant nous restons prisonniers de la haine, de la cupidité et de la peur. La prochaine grande révolution ne sera ni technologique ni politique, elle sera mentale.
Aujourd’hui, négliger son esprit a un coût dévastateur. La dépression et l’anxiété touchent plus de 970 millions de personnes dans le monde (OMS 2023). L’impact économique des troubles mentaux est estimé à 1 000 milliards de dollars par an en perte de productivité. Pourtant, les pays consacrent en moyenne moins de 2 % de leur budget de santé à la santé mentale. La contradiction est flagrante : nous investissons dans des armes pour nous détruire, mais pas pour apaiser nos consciences.
L’esprit colonisé est toujours vivant. Les algorithmes des réseaux sociaux captent l’attention de 4,8 milliards d’utilisateurs actifs et façonnent les perceptions collectives. Chaque personne passe en moyenne sept heures par jour devant un écran (We Are Social 2024). Ce n’est pas un hasard : l’industrie numérique pèse plus de 5 500 milliards de dollars et son activité principale consiste à manipuler les désirs, à diviser les sociétés et à exploiter l’attention comme une marchandise.
Mais l’esprit peut aussi être un terrain d’émancipation. Des expériences d’éducation communautaire ont montré qu’avec seulement trois à cinq années de scolarité de qualité, les taux de violence chez les jeunes peuvent chuter jusqu’à 40 % dans les communautés vulnérables (UNESCO).
Les programmes de méditation et de santé mentale dans les écoles ont réduit les symptômes d’anxiété chez 60 % des élèves dans des pays comme l’Inde et le Canada.
La frontière mentale est la plus difficile à franchir, car aucune machine ne peut la franchir à notre place. C’est l’espace qui détermine si l’humanité se libère de la haine ou s’enferme dans de nouvelles cages numériques. Sans révolution des consciences, aucune autre frontière (technologique, sociale, sanitaire ou politique) n’aura de sens. L’avenir commence dans l’esprit de chacun, et cet esprit est aujourd’hui à saisir.
11. Des chiffres
- Investissement mondial dans l’intelligence artificielle : 190 milliards de dollars (2024)
- Coopératives dans le monde : 3 millions, avec 1,2 milliard de membres
- Les 1 % les plus riches contrôlent 45 % de la richesse mondiale (Oxfam 2024)
- Décès par cancer par an : 10 millions (OMS)
- Diabète : 537 millions d’adultes (FID)
- Démocraties complètes : seulement 24 pays sur la planète
- Émissions mondiales de CO₂ : 37,4 milliards de tonnes (2023)
- Déplacés pour des raisons environnementales : 43 millions au cours de la dernière décennie
- Déforestation : 10 millions d’hectares de forêt perdus chaque année.
- Eau potable : 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable (ONU-Eau)
- Dépenses militaires mondiales : 2,44 billions de dollars (2023)
- Aide humanitaire : seulement 46 milliards de dollars
- Armes nucléaires : 12 100 ogives, dont 90 % aux mains des États-Unis et de la Russie
- Espérance de vie maximale : 122 ans (record humain)
- Investissement dans la longévité : 40 milliards de dollars en thérapies
- Projets de villes intelligentes : plus de 250 en construction
- Population religieuse : 6,7 milliards de personnes (84 % de l’humanité)
- Sans affiliation religieuse : 1,2 milliard de personnes
- Impact économique de la dépression : 1 000 milliards de dollars par an
- Temps passé devant un écran : en moyenne 7 heures par jour et par personne
La prochaine frontière ne se mesure pas en kilomètres ou en satellites, ni en murs ou en armées.
Elle se mesure à la décision de l’humanité d’abandonner la cupidité comme moteur et la guerre comme destinée. Nous avons franchi toutes les frontières matérielles : le feu, l’atome, l’espace. Il nous reste la plus difficile à franchir, celle qui est invisible sur les cartes : la frontière mentale et éthique.
Soit nous continuons à répéter l’histoire d’il y a 3 900 ans, avec des peuples dévastés et des richesses pillées, soit nous osons reconstruire la planète sur la base de la justice et de la coopération.
Nous disposons des ressources, de la science et des chiffres pour le prouver. Ce qui manque, c’est la volonté politique, la solidarité mondiale et le courage de briser la logique du pouvoir qui a gouverné jusqu’à présent.
L’avenir ne sera pas un cadeau, ce sera une conquête. La prochaine frontière ne sera pas la conquête de Mars, mais celle de la dignité sur Terre.
C’est la seule épopée qui mérite notre temps….
Références :
- Oxfam (2024). Rapport sur les inégalités.
- Banque mondiale (2023–2024). Indicateurs du développement dans le monde.
- OMS (2023). Estimations de la santé mondiale.
- Fédération internationale du diabète (2023). Atlas du diabète.
- SIPRI (2024). Base de données sur les dépenses militaires.
- NOAA (2024). Rapport sur l’état du climat.
- FAO (2023). Évaluation des ressources forestières mondiales.
- ONU Eau (2023). Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau.
- Pew Research Center (2023). Religion et vie publique.
- Alliance coopérative internationale (2024). Rapport mondial sur les coopératives.
- Rapports sectoriels sur la longévité (2024). Analyse du marché mondial de la longévité.
- WWF (2022). Rapport Planète Vivante.
- Programme de données sur les conflits d’Uppsala (2024). Base de données sur les conflits armés.
- Nous sommes sociaux (2024). Rapport mondial sur le numérique.
- HCR (2024). Tendances mondiales des déplacements forcés.




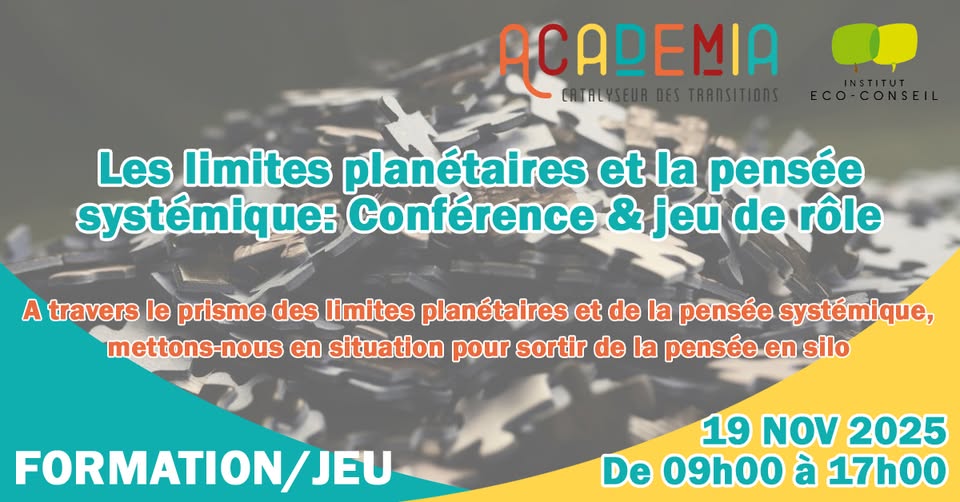
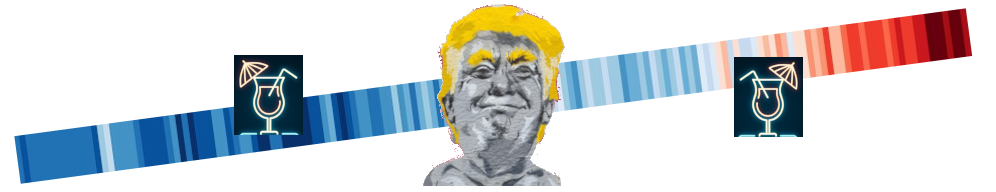


:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/JJMLN3BETVFDRHEXGVJZ6NU6TU.png)