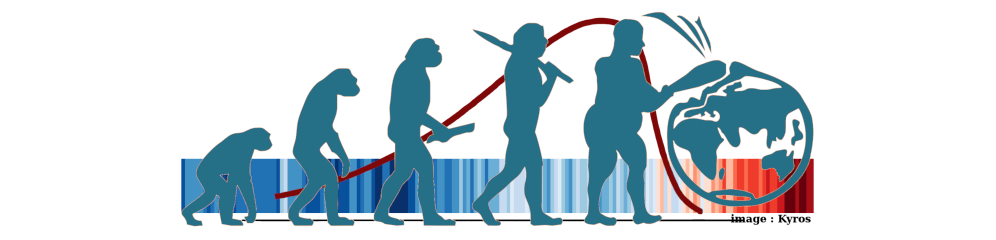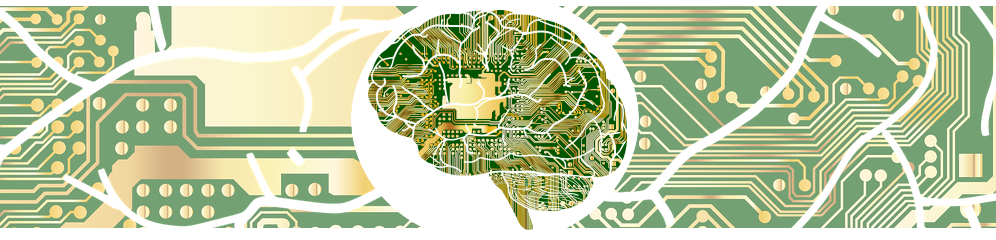Et si la troisième guerre mondiale avait déjà commencé ?. Au travers de cette hypothèse, Albin Wagener – Professeur d’université en Sciences du langage et Sciences de l’information et de la communication – évoque l’étrange période dystopique que nous vivons en ce premier quart du 21ième siècle. Sommes-nous déjà en guerre mondiale ?
Bonne lecture. ObsAnt
Reprise – texte publié le 3 février ici
Et si la troisième guerre mondiale avait déjà commencé ?
Albin Wagener (*)
A première vue, vous pourrez probablement penser que l’auteur de ces lignes est soit en train de traverser un épisode de déprime passagère nourri par un doomscrolling trop intensif, soit qu’il s’aventure bien loin de ses terrains d’expertise habituels. Les deux seraient inquiétants, cela va sans dire.
Pourtant, je souhaite que nous considérions un instant cette hypothèse, mais en oubliant ce que signifient pour nous les première et deuxième guerres mondiales. En d’autres termes, il s’agit d’ôter non seulement le prisme occidentalo-centré qui nous a permis de raconter les deux premières, et également de ne pas lire la situation du vingt-et-unième siècle avec la grille de lecture du vingtième – erreur hélas trop commode pour bon nombre de sujets. En effet, nous avons changé de siècle, et le siècle dans lequel nous nous trouvons voit une explosion de concepts le qualifier : anthropocène, accélérationisme, disruption digitale, ensauvagement, techno-fascisme… autant de termes qui redéfinissent un siècle, avec une vision générale peu optimiste.
Les différentes excroissances de nos sociétés, qui polluent d’une manière ou d’une autre notre rapport aux autres, aux médias, au système social et économique, ou tout simplement à nous-mêmes, semblent en réalité montrer qu’une guerre d’un tout nouveau genre a éclaté il y a quelques années déjà, et que nous n’en avons pas encore conscience – tout simplement parce que le théâtre des opérations n’a rien à voir avec les références atroces héritées du siècle dernier.

Le retournement récent des géants de la tech de la Silicon Valley, au moment où Donald Trump accédait à nouveau au pouvoir le 20 janvier 2025, constitue l’un des indices les plus importants. En effet, au moment même où le binôme de choc Trump/Musk accédait aux affaires de la première puissance mondiale, tels des Minus et Cortex sous acide et avec les codes de la valise nucléaire, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg abandonnaient sans vergogne leur politique de diversité. Une manière éclatant de montrer que, depuis le début, les grands patrons de la tech n’ont soutenu les mouvements #BlackLivesMatter et autres #PrideMonth qu’à partir du moment où cela servait leurs intérêts commerciaux, et que ces mouvements étaient importants pour leurs clients.
Cela peut paraître évident et relativement anodin, si on le formule de cette manière. Mais en réalité, ce volte-face si abrupt, après une bonne quinzaine d’années d’engagements plus ou moins feints sur le sujet, montre tout simplement que les droits humains, le progrès social et la dignité citoyenne sont des concepts qui n’ont absolument ni intérêt, ni valeur, pour ces personnages. Le problème, c’est qu’entretemps, ces patrons nous ont rendus dépendants à leur plateforme, et se sont incrustés si profondément dans nos modes de vie et dans notre culture que nous sommes désormais cognitivement et affectivement liés à leurs produits.
Guerre cognitive
D’une certaine manière, la troisième guerre mondiale a commencé à partir du moment où nous avons laissé notre attention et notre cognition devenir le nouveau théâtre des opérations de nos agresseurs. Ces agresseurs ont toujours eu pour but de coloniser notre temps d’attention, quelle que soit notre classe sociale, notre inclinaison politique ou nos préférences. Et on aurait tort ici de ne viser que les réseaux sociaux, ce qui serait particulièrement commode.

Car évidemment, il ne s’agissait pas simplement de nous forcer à nous inscrire sur un réseau, d’y publier des photos ou de s’y faire des amis : il s’agissait de nous rendre dépendant à un tout nouveau mode de vie, entre commandes inopinées sur internet à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, discussions anodines transformées en micro-scandales et en cyber-harcèlement, nouvelles formes de séduction, captation de l’attention par des vidéos courtes conduisant à un reformatage cognitif, commandes vocales connectées colonisant nos espaces domestiques… absolument rien n’a échappé aux récents développements technologiques. Notre attention est devenue une ressource que l’on se dispute, et que nous vendons bien volontiers, pensant qu’il ne s’agit que de transactions anodines basées sur le divertissement.
Car dans ce pacte faustien, les avatars du divertissement suffisent à nous vendre n’importe quoi, à nous soumettre et à nous garder tranquilles, captifs dans ces petites bulles de facilité et de confort, qui après tout ne nous font pas réellement de mal. Et puis est-ce si grave d’offrir ainsi nos données personnelles, dont on n’avait pas réellement conscience avant cette époque ? En quoi cela pourrait-il être dangereux ?
Guerre environnementale
Tandis que nous sommes confits dans la douce quiétude de ce monde ultraconnecté aux services si agréables, et que notre terrain cognitif et affectif devenait désormais domestiqué, une autre guerre a pu ouvertement se déclencher : la guerre environnementale. Bien sûr, elle n’a pas démarré au vingt-et-unième siècle, loin s’en faut ; cela fait plusieurs décennies que les lobbies pétroliers et les politiques ultraconservateurs bataillent pour reculer les mesures permettant de lutter contre le changement climatique.

Mais cette fois, cela va plus loin : la guerre est menée au grand jour, à grands renforts de propos climatodénialistes ouvertement relayés dans des émissions à fort taux d’audience, alors même que les scandales sanitaires et environnementaux ne font que s’accumuler. Mais peu importe : le changement climatique est la faute des écologistes, les dégâts environnementaux sont la faute des agences chargées de surveiller l’environnement, et les catastrophes naturelles sont de la responsabilité des météorologues.
Cette guerre est menée contre ce qui nous fait vivre en tant qu’espèce et nous relie à tout le vivant : notre planète, tout simplement. Il ne s’agit pas ici que de réchauffement global, mais également de pollution environnementale ou d’agressions répétées et incessantes contre la biodiversité. Après avoir fait de notre mental leur meilleur allié, ces mêmes forces au capital important, dominantes économiquement, ont poursuivi leurs attaques contre notre monde – des attaques déjà largement entamées au moment des grandes colonisations occidentales du dix-neuvième siècle, avec le même sens aigu de l’impérialisme, du mépris pour tout ce qui n’est pas comme eux, et du goût du massacre.
Guerre médiatique
Mais pour garder captif notre espace mental, cognitif et affectif, et attaquer l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et la terre que nous cultivons, il était bien évidemment nécessaire de contrôler les canaux d’information qui nous auraient permis d’obtenir des informations objectives et des données fiables, susceptibles de nous faire réagir. Ici aussi, la guerre remonte à loin, mais elle a fini par prendre des proportions totalement incroyables depuis le début du vingt-et-unième siècle.

Cette guerre médiatique a permis d’abord d’installer un nouveau régime de parole : le régime de l’opinion. Ce régime n’a pas démarré au moment des réseaux sociaux, qui n’ont fait que l’amplifier : il trouve en réalité sa source dans les quelques talk shows un peu grossiers de la fin du siècle dernier, puis dans l’explosion des chaînes d’information en continu, qui exigent de ses invités des punchlines plus efficaces que de longues démonstrations savantes. Ainsi, dans ce régime de l’opinion, le scientifique expert ne peut rien contre l’éditorialiste toutologue, et le second parvient alors systématiquement a donner à son propos les atours d’une parole rationnelle et fondée, même et surtout lorsqu’elle n’est basée sur rien.
Outre cette reconfiguration des régimes de parole dans l’espace public, médiatique et donc démocratique, d’autres grandes fortunes ont décidé de faire main basse sur plusieurs titres et chaînes de télé, constituant d’immenses groupes de presse qui finissent par soutenir une idéologie dominante, capable de défendre les intérêts financiers, fiscaux et idéologiques des patrons en question. Ainsi, dans ce cas de figure, nous nous retrouvons face à une information qui n’est non pas savamment construite pour nous manipuler de manière grossière, mais qui est plutôt là pour diffuser une petite musique thématique incessante à laquelle nous finissons par nous habituer puis nous conformer, avec des avis sur l’actualité partagés par une majorité si large d’éditorialistes qu’ils doivent forcément avoir raison.
Guerre sociale
La guerre se joue également sur le terrain social. Pendant que nous sommes occupés à nous plonger dans le nid douillet de notre confort cognitif, que nous continuons à adopter des habitudes qui agressent notre environnement, et que nous cédons aux opinions dominantes de certains médias, les mêmes coupables démantèlent, avec plus ou moins de zèle et de subtilité, nos Etats – ou à tout le moins nos régimes de protection et de redistribution, qui permettent aux citoyens de vivre dignement et d’être de véritables acteurs de la démocratie.

Car bien évidemment, il serait illusoire de penser que les patrons des lobbies pétroliers, les patrons des groupes de presse et les patrons de la tech n’aient pas les mêmes objectifs, à savoir : conserver un maximum de richesse de leur côté, les accumuler de manière toujours plus éhontée, année après année – et s’assurer qu’aucun Etat ni aucune politique trop humaniste ne viendra mettre son nez dans cette belle affaire. Ainsi, il faut donc peser suffisamment dans la vie politique des Etats, soit en finançant les programmes de ceux qui promettent de maintenir un système législatif et judiciaire suffisamment permissifs pour maintenir le grand déséquilibre capitaliste, soit désormais en prenant le contrôle de ces Etats – comme c’est le cas avec Elon Musk aux Etats-Unis.
Bien sûr, la brutalité face aux exploités n’a hélas pas attendu le vingt-et-unième siècle ; mais cette brutalité va s’accélérer, avec l’explosion des inégalités, de l’appauvrissement graduel de nos populations, et du sentiment de déclassement des classes moyennes supérieures – que l’on retournera facilement contre les classes qui se trouvent en-dessous d’elles. Et comme nous pouvons déjà le voir aux Etats-Unis, toutes les communautés les plus vulnérables en souffriront encore plus : femmes, personnes trans, enfants, personnes racisées, communautés LGBTQIA+ dans leurs ensemble, personnes handicapées – et je pourrais continuer tant la liste est longue. Ces discriminations vont s’accompagner d’une paupérisation grandissante et de l’articulation de fragmentations de plus en plus grandes entre ces communautés – alors que celles-ci auraient tout intérêt à s’unir pour se retourner contre leurs véritables ennemis.
La 3ème guerre mondiale a déjà commencé
Cette guerre s’attaque à 4 terrains distincts, de manière coordonnée : le terrain de l’intime (via la guerre cognitive), le terrain planétaire (via la guerre environnementale), le terrain de la circulation de l’information (via la guerre médiatique) et le terrain des structures sociales (via la guerre sociale). En d’autres termes, si nous ne repolitisons pas l’ensemble de ces espaces, et que nous théorisons et mettons en mouvement une lutte politique méthodique et intellectuellement fournie, nous risquons toujours de tomber dans les mêmes pièges et les mêmes écueils.
Car nous n’avons pas la puissance financière – et donc, de ce fait, pas la puissance d’influence capable de faire basculer un pays, une loi, une ligne éditoriale ou un code pour une nouvelle application. Si cette troisième guerre mondiale a déjà commencé, ce n’est pas tant par ses thématiques (dont certaines sont relativement anciennes) que par la concaténation de l’ensemble de ces terrains : nous sommes attaqués partout, en même temps, et cette guerre se joue désormais à un niveau trans-continental jamais atteints. Elle est menée par un tout petit pourcentage de la population mondiale contre l’intégralité de l’espèce humaine – et contre l’intégralité des espèces vivantes présentes sur la planète, cela va sans dire.
Dans cette guerre, nous n’avons pas vraiment d’alliés, mis à part nous mêmes. Nous sommes des milliards, certes, mais nous sommes faciles à berner, car l’intégralité des structures qui nous relient les uns aux autres, ainsi qu’à nous-mêmes, se retrouvent corrompues de manière brutale, insidieuse et indigne par des individus qui n’ont pour nous ni considération, ni reconnaissance, ni respect. Nous ne sommes que des instruments dans l’accroissement de leurs richesses. Nous sommes les munitions des armes qu’ils dirigent contre nous, comme les réseaux sociaux par exemple – au sein desquels nous sommes si prompts à nous diriger les uns contre les autres, au détour d’un commentaires, d’une republication ou d’un émoji mal placé.

Nous devons pouvoir faire autrement. Mais cela implique, entre autres, de faire probablement des choix radicaux sur l’ensemble de ces quatre théâtres d’opération. Des choix qui demandent sevrage, courage, et probablement une théorisation claire qui permet d’expliciter, de parler, de donner à comprendre et à apprendre auprès de nos pairs. Nous devons relier l’ensemble de ces problématiques, car en face, c’est donc bel et bien un fascisme d’un nouveau genre qui se dresse face à nous – une forme de radicalité violente, inhumaine et discriminatoire qui va désormais chercher, coûte que coûte, à nous imposer un ordre brutal.
Ils le feront en nous mettant en situation de surcharge mentale, en laissant brûler notre planète, en nous abreuvant d’informations fausses et en détruisant ce qui fait de nos sociétés, déjà si imparfaites et passablement injustes, des espaces de solidarité et de dignité. Bien sûr, il ne s’agit pas de dire que cette troisième guerre mondiale doive évacuer de l’esprit les guerres réelles et leurs atrocités qui se multiplient à travers le monde ; mais toutes ces guerres sont liées. Et dans tous ces cas de figure, des personnes réelles peuvent se retrouver privées de droit, en danger pour leur vie ou celle de leurs proches, obligées de survivre dans des situations de vulnérabilité inimaginables.
Cette guerre, c’est probablement l’enjeu de ce siècle. Parce que nous n’avons jamais aussi clairement vu nos ennemis. Ils ne sont jamais aussi clairement sortis du bois, préférant laisser les Etats en faillite au lieu de participer à leur sauvegarde – parce que leur but n’a jamais été l’équilibre économique des Etats, contrairement à ce que la bonne doxa néolibérale souhaite faire penser. Le but est de brûler l’intégralité de ce qu’ils peuvent brûler, tant qu’ils le peuvent encore, et d’amasser jusqu’aux derniers grammes de profit matériel, de l’ôter de nos mains, jusqu’à ce que nous ayons suffisamment de rage pour nous entretuer, mais pas assez d’énergie pour nous liguer contre eux.
Bibliographie
Delpech, Thérèse (2005). L’ensauvagement. Le retour de la barbarie au XXIè siècle. Grasset/Fasquelle.
Eco, Umberto (2017). Reconnaître le fascisme. Grasset.
Ertzscheid, Olivier (2017). L’appétit des géants. Pouvoir des algorithmes, ambitions des plateformes. C&F Editions.
Henschke, Adam (2025). Cognitive Warfare. Grey Matters in Contemporary Political Conflict. Routledge.
Malm, Andreas (2021). How to Blow Up a Pipeline : Learning to Fight in a World on Fire. Verso.
Piketty, Thomas (2013). Le Capital au XXIè siècle. Seuil.
Prévost, Thibault (2024). Les prophètes de l’IA. Pourquoi la Silicon Valley nous vend l’apocalypse. Lux.
Rosa, Hartmut (2005). Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Suhrkamp.
Stiegler, Bernard (2016). Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Les Liens qui libèrent.
Swartz, Aaron (2016). The Boy Who Could Change the World : The Writings of Aaron Swartz. The New Press.
Taylor, Mark C. (2014). Speed Limits. Where Time Went and Why We Have So Little Left. Yale University Press.
Traverso, Enzo (2017). Les nouveaux visages du fascisme. Textuel.
Wagener, Albin (2019). Système et discours. Peter Lang.
Wallenhorst, Nathanaël (2023). A critical theory for the anthropocene. Springer.
Zuboff, Shoshana (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.