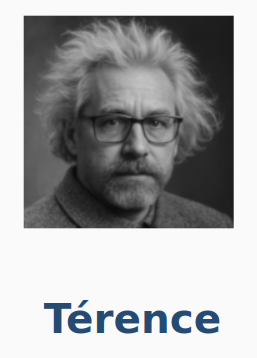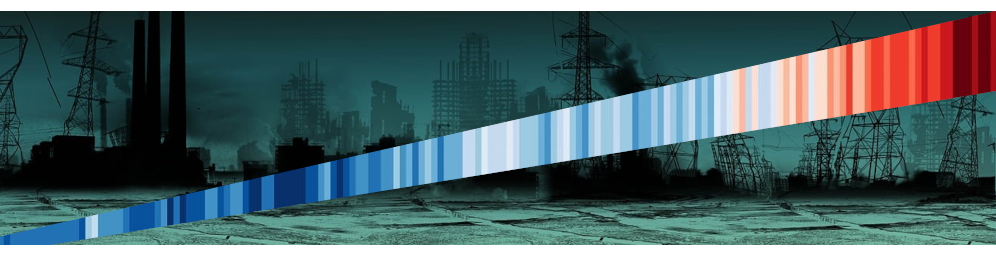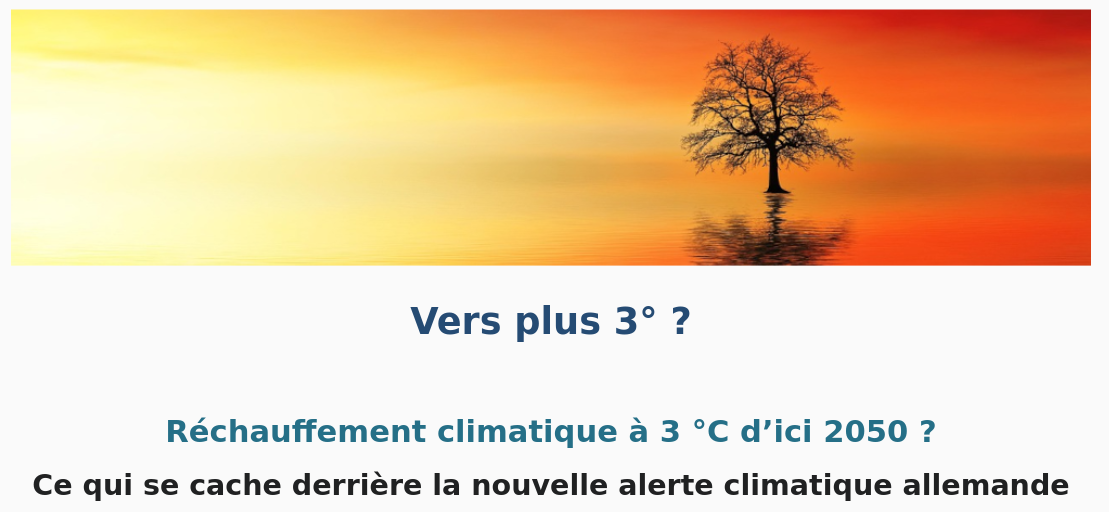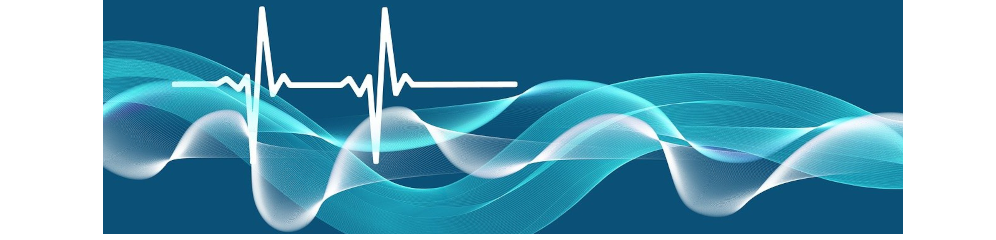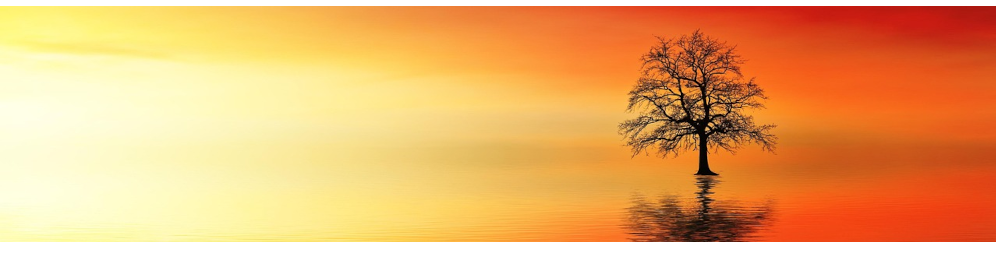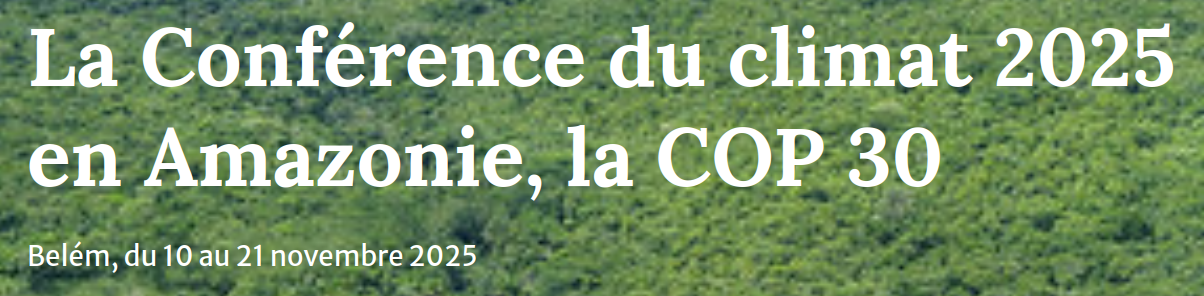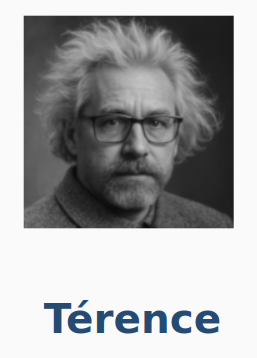Térence
Reprise de l’article Résumé de la COP30 à Belem – « Y a-t-il un passage étroit ? » paru sur le blog de Paul Jorion
Les journalistes experts du Guardian viennent de résumer en deux articles la COP30 qui vient de se terminer à Belem, au Brésil.
Compromises, voluntary measures and no mention of fossil fuels: key points from Cop30 deal | Cop30 | The Guardian
Cop30’s watered-down agreements will do little for an ecosystem at tipping point | Cop30 | The Guardian
Un scientifique d’envergure internationale nous ramène à la réalité du système climatique, encore qu’avec un certain euphémisme, puisque d’autres de ses collègues et le Secrétaire général de l’ONU estiment, non sans raison, que l’objectif de 1,5°C est mort :
Johan Rockström, directeur de l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam et professeur de sciences du système terrestre à l’université de Potsdam, a déclaré : « La vérité est que notre seule chance de maintenir l’objectif de 1,5 °C à portée de main est de faire baisser la courbe mondiale des émissions en 2026, puis de réduire les émissions d’au moins 5 % par an. [Cela] nécessite des feuilles de route concrètes pour accélérer l’élimination progressive des combustibles fossiles et la protection de la nature. Nous n’avons ni l’un ni l’autre. »
Nous allons également assister, dans les prochains jours, à l’éternel bal des interprètes de la COP.
En début de soirée, ce sera la valse des optimistes (aussi appelés « naïfs » par les pessimistes), puis le chachacha des « réalistes » (ceux qui aiment peser le pour et le contre en se croyant plus malins que les optimistes et les pessimistes), enfin, la soirée se conclura par le tango des pessimistes (aussi appelés « catastrophistes » par les optimistes). Shakespeare serait sans doute très inspiré par ce bal des illusions, ce tableau parlant, tandis que les émissions et la concentration en gaz à effet de serre mondiales continuent à augmenter, malgré 30 ans de COP.
Votre serviteur voudrait ajouter quelques réflexions personnelles, issues de son expérience dans les couloirs des gouvernements.
Ce qui me frappe dans les COP, depuis que je les suis de près ou de loin (soit depuis 2010), c’est cette insistance sur le « consensus unanime », « pour sauver le multilatéralisme ».
Or il existe, représentés à l’ONU et négociateurs lors des COP, des pays comme l’Arabie Saoudite (une monarchie absolue de droit divin, une dictature cruelle qui dissout le corps d’un journaliste dans l’acide, un des régimes autoritaires les plus sanglants de la planète) et la Russie (une dictature agressive qui torture et assassine tous ses opposants, y compris à l’étranger, et qui a déclenché la pire guerre en Europe depuis la désintégration de la Yougoslavie).
Sans compter la Chine, qui est aussi une des dictatures les plus impitoyables au monde, au point de menacer directement ses critiques dans les démocraties, et dont les efforts en matière d’énergies renouvelables ne permettent pas d’annuler ses immenses émissions de gaz à effet de serre, en passe de dépasser celles, cumulées, des plus grands émetteurs historiques occidentaux.
Tandis qu’un régime comme l’Inde, nominalement la plus grande démocratie du monde, est dirigée par un individu proche de l’extrême-droite nationaliste, tout en ayant des émissions massives, seulement limitées par la pauvreté de sa population.
Enfin, l’absence des États-Unis est liée à la présence d’un proto-dictateur à sa présidence. Or les USA sont un des premiers pollueurs climatiques au monde.
Et ne négligeons pas l’essor des dirigeants d’extrême-droite dans plusieurs pays d’Union européenne. Nous participons également à la grande parade de la destruction de la démocratie dans le monde.
Si l’honnêteté intellectuelle impose de comparer les émissions par habitant (qui restent supérieures en Europe et aux États-Unis à celles de la Chine et de l’Inde), et d’évaluer les émissions historiques cumulées, on ne peut pas non plus se satisfaire de l’excuse du développement du Sud, auquel le Nord a eu droit par le passé, pour pardonner aux grandes puissances du Sud global leur opposition systématique lors des COP.
Car ce n’est pas parce qu’une partie de la famille a incendié la moitié de la maison dans le passé que l’autre partie peut se prévaloir aujourd’hui du droit d’incendier ce qu’il en reste, peu importe les torts historiques de chacun. L’atmosphère planétaire n’a que faire de nos torts historiques. La physique est impitoyable et se conjugue au présent. La réalité c’est que le Sud ne peut pas se développer de la même manière que le Nord. Or c’est pourtant ce qu’il fait (mégapoles, autoroutes, aéroports, ports, consumérisme, etc.).
Un jour prochain, les émissions historiques du Sud seront supérieures à celles du Nord global. On découvrira alors que c’est moins l’Occident par essence que la contingence historique qui nous a rendus responsables de la révolution industrielle et de la colonisation du monde. Un argument en plus en faveur du constat que nous sommes une seule et même espèce. Et que les Orientaux, les Africains et les Américains du Sud aussi, peuvent être écocidaires, sans l’aide des Occidentaux.
L’insistance sur le consensus unanime « pour sauver le multilatéralisme », quand on négocie avec de telles tyrannies, et quand les plus grandes démocraties du monde (Inde et USA) versent dans l’autoritarisme écocidaire, me laisse songeur.
Une autre étrangeté depuis les origines des COP est l’omniprésence des industriels, en particulier ceux de l’industrie des énergies fossiles (émissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles fossiles) et de l’agro-alimentaire (déforestation donc destruction des puits de carbone et émissions de méthane par l’industrie de la viande). Sans compter les grands complexes industriels comme celui de la construction, de l’automobile, de l’aviation, des GAFAM, du tourisme international et de l’armement, qui ne sont que le corolaire, les usagers, du complexe énergétique fossile.
N’avait-on pas banni les industriels du tabac des accords mondiaux sur la santé ?
Ce qui m’étonne en conséquence, c’est que les « autres pays » : ceux qui apparemment voudraient vraiment avancer, les pays du Sud et du Nord démocratiques (dont l’Union européenne) – ou du moins, pas suffisamment démocratiques mais sincèrement préoccupés par le climat – ne concluent-ils pas, entre eux, un traité légalement contraignant, pour sortir des énergies fossiles et réduire leurs émissions de GES. Faut-il attendre un improbable consensus mondial ? Avec des États qui sont des tyrannies et se soucient de leurs citoyens comme d’une guigne ?
Pourquoi ne pas avancer sans eux ?
On me dira : « Oui mais ça ne sert à rien d’agir sans les USA, la Chine, l’Inde et la Russie, qui représente la plus grande masse des émissions mondiales ».
Je répondrais : « Agir sans eux réduirait pourtant notoirement les émissions mondiales et surtout, cela autoriserait notre coalition d’ambition à installer des barrières géopolitiques pour contraindre les États qui ne veulent pas bouger » (comme des droits de douanes climatiques).
Il existe des stratégies « du faible au fort ». De quels atouts disposons-nous ?
L’Union européenne est par exemple un des premiers marchés économiques mondiaux.
L’Union européenne avançait dans cette voie jusqu’à encore récemment. Ses dernières décisions, qui vident de leur substance certaines législations du Green Deal, sèment le doute, pour le moins, sur son positionnement de leader mondial du climat. Si l’Europe n’est même plus leader de l’action climatique, que restera-t-il comme espoir au monde ?
Mais même l’Union européenne n’est pas dépourvue d’ambigüité.
En fait, certains pourraient soupçonner que les pays apparemment « volontaires » ne veulent pas sortir du multilatéralisme et de la règle du consensus à l’ONU pour une bonne raison : cela leur permet de conserver une trajectoire majoritairement énergies fossiles, en apparaissant comme des États vertueux, et en reportant la faute sur les États voyous.
Mon parcours en politique m’a illustré de nombreuses fois la « règle du valet puant ». Dans ce jeu de cartes, le but du jeu est de ne pas être le dernier joueur en possession du valet de pique, dit le « valet puant ». Il s’agit d’un jeu de rôles où certains négociateurs autour de la table ne veulent pas qu’une décision courageuse soit prise, veulent éviter d’apparaitre comme des opposants à l’accord, et cherchent à reporter la faute du désaccord sur d’autres négociateurs, accusés de tout bloquer.
Tout l’art politicien est de tirer parti des opportunités d’illustrer son courage et sa vertu théoriques, quand on sait à l’avance qu’on ne court aucun risque de devoir en faire usage en pratique. Comme se porter « courageusement » volontaire pour participer à un bataille, au dernier moment, alors qu’on sait que la guerre sera terminée avant. Si l’on est certain qu’un négociateur va tout refuser, c’est l’occasion inespérée d’afficher son volontarisme vertueux, en communiquant abondamment sur sa frustration de voir l’ambition bloquée par cet infâme opposant.
Parfois, je me demande si de nombreux pays dits « volontaires » ne veulent pas, en réalité, que rien ne change, ne sont pas prêts à prendre des décisions courageuses devant leur électorat, et se révèlent bien soulagés que l’Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, l’Inde (et les États-Unis quand ils participent) existent pour tout bloquer.
Je ne serais pas étonné qu’il y ait une part de vérité dans ce soupçon, malgré son injustice pour les pays sincères.
Je m’étonne par exemple de la position de certains États européens à Belem, dans la coalition des États ambitieux et volontaires, qui ont réclamé une feuille de route de sortie des énergies fossiles. Je n’ai pas l’impression que ce sont les mêmes États qui s’expriment sur notre continent, au siège de leurs gouvernements, au sein des institutions européennes.
Enfin, il est possible que même ce soupçon soit une illusion.
Le problème climatique est considéré comme un super wicked problem ( Wicked problem – Wikipedia). Il est sujet au fameux « dilemme du prisonnier » (Prisoner’s dilemma – Wikipedia) et représente une « tempête morale parfaite » pour certains philosophes ( A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change | Oxford Academic).
Cependant, peu de commentateurs ont évoqué un problème encore plus fondamental : celui de la possibilité biophysique de la réglementation de la mégamachine mondiale humaine, c’est-à-dire de la réduction de la vitesse et de la taille des flux de matière, d’énergie et d’information de l’économie mondiale humaine. Ou, en termes philosophiques conceptuels : notre espèce est-elle capable d’instituer la Limite ?
Aujourd’hui, la puissance géopolitique est indexée sur la puissance militaire, elle-même indexée sur la puissance économique, à son tour indexée sur l’usage massif et croissant de matière et d’énergie, reposant essentiellement sur les combustibles fossiles et fissiles.
Sortir des fossiles, c’est décroitre. Décroitre, c’est baisser la garde. Baisser la garde, c’est perdre sa souveraineté et sa puissance.
Depuis plusieurs années, les démocraties redécouvrent la politique, brutale et sans pitié, de la puissance, et l’usage de la coercition économique et de la force militaire. La boussole du droit international et du règlement diplomatique des conflits est cassée.
Les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde, etc., parlent le langage de la puissance géopolitique.
L’Union européenne, à son tour, y est forcée. On réarme. Y compris démographiquement, si possible.
S’engage alors la fameuse « course aux armements », qui n’est pas que liée aux armements stricto sensu. Il s’agit, pour chaque bloc de puissance, de s’assurer du maintien de sa puissance, et même d’un iota supplémentaire, pour dissuader les autres blocs de prendre l’ascendant, et minimiser le risque que sa propre puissance soit neutralisée, ou bien a contrario de permettre de prendre l’ascendant sur eux et de les neutraliser.
On a souvent justifié l’agression par la nécessité de prévenir l’agression d’autrui.
Une sorte d’hypothèse de la Reine Rouge, issue initialement des recherches en biologie sur les théories de l’évolution (Red Queen hypothesis – Wikipedia), se révèle ainsi en matière géopolitique. Il faut courir pour ne pas être dépassé par ses adversaires, et courir de plus en plus vite.
Tant que la puissance est indexée sur les combustibles fossiles, comment imaginer qu’à Belem, lors de la COP30, les différents blocs géopolitiques les plus puissants acceptent la moindre feuille de route de sortie des énergies fossiles ?
Ce serait baisser la garde au moment où le monde réarme, et où le « Grand Jeu » recommence (Nouveau Grand Jeu — Wikipédia).
Si, comme certains penseurs en écologie le pensent, nous sommes face à une indexation forte de la puissance géopolitique sur les énergies fossiles, dont nous devrions nous débarrasser pour réduire l’impact du réchauffement climatique, alors nous avons *un léger problème*.
Certains pourraient en conséquence estimer que l’humanité est condamné à poursuivre l’exploitation fossile, à cause du grand jeu géopolitique des puissances, jusqu’à ce que la seule boucle de régulation qui puisse y mettre fin soit celle du système Terre lui-même, via les catastrophes climatiques (et écologiques en général) de plus en plus critiques (ce que certains appellent « l’effondrement »).
Il existe toutefois des exemples où les humains ont limité, même imparfaitement, la course aux armements (effet Reine Rouge) entre grandes puissances, celui des traités de limitation et de désarmement nucléaires.
Il est peut-être opportun de rappeler aujourd’hui que cet outil pourrait également s’appliquer au problème climatique. On ne parlerait plus du « climat » ou des « émissions » (les conséquences) mais des causes fondamentales, c’est-à-dire des combustibles fossiles, comme on ne parlait pas de traité sur « l’holocauste nucléaire » ou les « retombées radioactives » des bombes (les conséquences) mais bien du nombre de têtes nucléaires actives et de leur réduction immédiate, c’est-à-dire des causes fondamentales.
Une telle idée existe et a été défendue par 100 prix Nobel, elle s’appelle « Traité de non prolifération des combustibles fossiles » (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative – Wikipedia ; en français — Traité de Non-Prolifération des Combustibles Fossiles).
Si la course à la puissance est un effet émergent du système réel, et qu’il repose sur une dynamique qui conduit à l’extermination du genre humain (bombes nucléaires ou combustibles fossiles – ou les deux), le meilleur outil que nous ayons, sans garantie de succès, est peut-être que les grandes puissances reconnaissent ensemble l’impasse dans laquelle nous conduit l’accélération concurrentielle, et décident, ensemble, de s’auto-limiter mutuellement, par un traité contraignant.
Les outils de contrôle mutuel existent. Les arsenaux nucléaires ont réellement baissé, de manière drastique, suite à ces traités, même s’ils restent une menace existentielle pour l’humanité.
Outre les accords de l’ONU au « consensus » et « sauvant le multilatéralisme », il existe donc deux autres pistes :
– la conclusion d’un traité international contraignant entre « pays volontaires », jusqu’à forcer les grandes puissances à en tenir compte ;
– la conclusion d’un traité international contraignant entre « grandes puissances », jusqu’à forcer les autres pays à en tenir compte.
Tout traité contraignant permettant d’agréger progressivement une partie des nations du monde en ce sens pourrait servir d’étape intermédiaire vers ces objectifs. Une « prise en tenaille » des pays derniers récalcitrants, par mixte des deux pistes supra, est envisageable.
Mais que la voie est étroite, entre le gouffre et le précipice, et comme nous en sommes déjà proches !
Comme le dit Paul Atréides dans Dune :
« Nos ennemis nous entourent de partout et, dans de nombreux futurs, ils l’emportent. Mais je vois une issue. Il existe un passage étroit. »